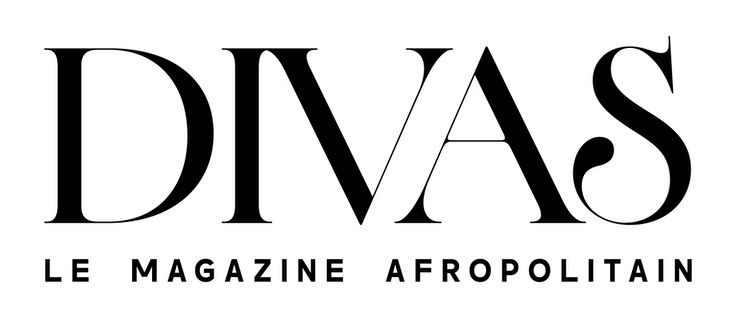Top model, championne d’athlétisme, actrice de cinéma…
et présidente de la Maison de l’Afrique qu’elle a fondée à Montpellier, la Sénégalaise Awa Sagna a déjà une longue et belle carrière en France. Interview exclusive.
Votre carrière commence très jeune…
Awa Sagna : J’ai toujours eu un parcours un peu atypique. J’ai d’abord commencé comme danseuse, grâce à Catherine Noël, ma prof de sport de l’école Georges Brassens à Vémars, un petit village de 300 habitants du Val d’Oise. C’est elle qui, la première, me met sur scène à l’âge de 6 ans !
Je la retrouve comme prof d’EPS (Éducation physique et sportive) au collège François Mauriac à Louvres (toujours dans le 95) et elle me met à l’athlétisme. Elle m’initie au 100 m et au saut en hauteur. C’est pour moi une révélation et je fais les championnats de France.
Ne va-t-elle pas vous faire découvrir aussi la montagne et le ski ?
Elle m’initie en effet au ski, ce qui n’est pas courant pour une Sénégalaise. Avec d’autres professeurs, ils se cotisent pour m’offrir mon premier séjour à la montagne à Orcières Merlette, dans les Alpes, ainsi que des chaussures de ski, comme ils m’ont déjà offert des « pointes » pour réussir sur les pistes d’athlétisme… C’est donc une belle histoire.
J’en parle aujourd’hui pour leur rendre hommage car les professeurs de nos plus jeunes années ont un impact clé pour toute notre vie. Mon instituteur, M. Lescure, me prend ainsi sous son aile en m’initiant à la langue de Molière. Moi, je lui fais découvrir l’Afrique et ma double culture franco-sénégalaise. Il me pose plein de questions sur le Sénégal, la polygamie de mon Papa, notre façon de vivre et lui, en retour, m’apprend des poèmes de Baudelaire et me fait découvrir Voltaire. Si j’adore aujourd’hui le français, c’est grâce à des personnes comme lui.

Comment êtes-vous arrivée en France et dans ce petit village du Val d’Oise ?
Je suis née à Paris, mais c’est une longue histoire. Avant d’arriver à Vémars, nous habitions à Sarcelles et Papa voulait alors prendre une seconde épouse. Maman n’était pas d’accord et n’en voulait pas à la maison. Cela tourne bien évidemment à la confrontation. Il veut la lui imposer mais Maman, qui est beaucoup trop occidentalisée pour accepter la polygamie, refuse. Un jour où Papa (qui travaillait alors à l’ambassade du Sénégal à Paris) rentre à la maison, il nous voit, Maman et moi, dans un camion avec toutes nos affaires. « Diarra, qu’est-ce que tu fais ? », lui lance Lamine, mon père. Et ma mère lui répond du tac au tac : « Tu as choisis une seconde épouse. Je mérite mieux que cela, je pars ! ». Maman est une femme très forte et n’a pas eu une seule larme ce jour-là. Moi, comme ma petite sœur bien évidemment, j’étais triste, mais en même temps j’étais également contente de me lancer dans une nouvelle aventure. Car je n’étais pas prête à accepter de vivre avec une deuxième Maman et d’autres frères et sœurs, même si par la suite j’ai appris à les connaître et que je m’entends bien aujourd’hui avec eux. J’avais alors 5 ans et demi et c’est ainsi que je débarque en CP à Vémars.
Mais n’êtes-vous pas très attachée aussi à vos racines sénégalaises ?
Comme je suis née dans le 12e arrondissement de Paris et le quartier Voltaire – mon auteur préféré – je dis toujours que je suis « Sénégauloise ».
J’ai 12 ans quand je vais pour la première fois au Sénégal : je découvre alors l’île de Gorée, enfin mon pays et mon continent. Avant ce voyage initiatique, j’ai cependant appris la langue grâce à mes parents et à ma grand-mère qui vient à Paris pour se faire soigner. C’est elle qui m’apprend le diola, le wolof et le pulaar. Maman est Peuhl avec un peu de sang guinéen et parle de nombreux dialectes africains alors que Papa est 100 % de Casamance.
Comment êtes-vous devenue mannequin ?
Maman, qui avait déjà défilé à l’époque avec Katoucha pour les plus grands couturiers, ne souhaitait pas que je sois mannequin et Papa n’en parlons pas ! Musulman pratiquant, il assimilait tout ce qui avait trait à l’artistique, à la débauche…
Pour moi, tout commence grâce à la regrettée Katoucha, qui est alors la muse d’Yves Saint Laurent. C’est elle qui me pousse, me valorise et m’ouvre la porte de mes premiers grands défilés de mode.
Une autre femme va m’aider : Almen Gibirila, dont l’agence « Black expérience » prend sous son aile de jeunes mannequins noirs dont elle estime qu’elles peuvent avoir le potentiel pour faire une carrière internationale.
Et vos premières photos de mode ?
C’est Dominique Martial, je m’en souviens, qui les a faites pour un grand magazine féminin en 1994, mais je n’avais que 15 ans et j’étais alors extrêmement timide…
Puis Thierry Mugler me choisit pour concourir au Best model of the world, un grand concours que font tous les top models de l’époque comme Naomi Campbell et Cindy Crawford. Il se passe en Turquie et aide sérieusement à lancer ma carrière.
N’avez-vous pas eu souvent un rôle de précurseur dans ce milieu ?
Je fus en effet le premier mannequin noire à faire une campagne de pub pour Cartier en 2004, il y a déjà 20 ans. Je n’étais pas prédestinée pour ce casting, mais – avec la complicité de mon booker – ce grand joaillier insista pour que je passe ce casting que j’ai réussi et décroché sur 100 mannequins !
Poser nue pour Cartier fut pour moi une grande première. C’était une campagne pour mettre à l’honneur ses nouvelles créations de bijoux. Cartier fait partie de ces grandes marques du luxe qui ont réussi à imposer des mannequins noirs dans leurs campagnes publicitaires. J’avais une telle complicité avec le photographe David LaChapelle, que j’ai complètement oublié ma nudité. Je faisais des chorégraphies de danseuse qu’il immortalisait avec talent.
Vous êtes toujours mannequin ?
Parfaitement. Je viens de signer il y a quelques semaines avec Triplice, une agence brésilienne, pour me représenter pour les défilés ou publicités en France comme à l’international. D’autant plus que c’est une agence polyvalente qui s’occupe aussi bien des mannequins que des actrices et travaille beaucoup avec les États-Unis. Or, j’ai souvent défilé à New-York que j’aime énormément.
N’êtes-vous pas aussi une actrice très convoitée ?
C’est vrai. Je n’ai encore que de petits rôles, mais je vais bientôt changer de registre. Tout récemment, j’ai ainsi donné la réplique à Lambert Wilson dans la série « La Maison » (Apple TV+), où il incarne à merveille le patron – raciste – d’une maison de haute couture. J’ai également tourné avec Omar Sy dans « French Lover », puis avec Fatou N’Diaye – qui joue dans « Fatou la Malienne » – pour « Sud-Est », que nous avons tourné à Montpellier et qui sortira en 2025 sur Canal +. J’ai aussi décroché un rôle dans « Turbulences au tribunal », un film qui traite de la polygamie. C’est un sujet que je connais bien car c’est un peu l’histoire de mon Papa… J’ai enfin des rôles dans plusieurs séries télévisées à succès comme « Un si grand soleil » sur France 3 ou « Demain nous appartient » sur TF1.
Quel succès ! Et votre carrière sportive est aussi riche ?
Le sport fait partie de ma vie depuis toujours : la danse et l’athlétisme d’abord. Mais je me suis mise aussi à la boxe française grâce à Sylvie Leriche, mon entraîneur de l’époque, qui m’a coachée jusqu’à m’emmener avec les garçons aux championnats de France à Liévin en 1997. C’est le fruit de sérieux entraînements et je lui en suis reconnaissante : elle a su me transmettre sa passion pour que l’on puisse faire des compétitions à haut niveau. Aujourd’hui, je sais me défendre.
J’ai fait aussi du handball à Roissy-en-France, où je jouais arrière gauche. J’ai ainsi touché à plusieurs disciplines. Sans oublier le ski, auquel j’ai pris goût et où je suis très à l’aise, même sur une piste noire.
De quoi s’occupe « Peulh Fulani » ?
C’est une startup que j’ai lancée en 2019, cela prend du temps de faire connaître une entreprise qui se veut disruptive. Peulh Fulani réalise des textiles avec des déchets plastiques marins et veut faire du haut de gamme. Ce n’était pas gagné d’avance. Comme c’est bien mieux accueilli aujourd’hui, j’ai candidaté au concours de la French Tech que j’ai remporté en 2024 en France. Petit à petit, beaucoup commencent à comprendre que l’on peut concilier mode, économie circulaire et business. Avec mon conjoint, on a créé le premier showroom virtuel immersif en 3D, pour faire connaître la marque et créer de jolies collections dans l’espace atypique qu’est l’univers du digital. Peulh Fulani est une marque écoresponsable qui s’inspire de ma double culture, des cultures du monde, à la fois de la haute couture et des traditions africaines. On utilise les tatouages et les imprimés africains, que l’on sublime sur du polyester recyclé, notre matière de prédilection.
« Peulh Fulani est une marque éco-responsable qui s’inspire de ma double culture »
Comment est née la Maison de l’Afrique de Montpellier que vous dirigez ?
Cette « Maison de l’Afrique, berceau de l’Humanité » s’est montée lors du sommet Afrique-France de Montpellier en octobre 2021. J’organisais déjà dans la ville pas mal d’événements autour du Continent et je voulais une association ouverte à tous qui puisse parler culture, numérique, arts. Car pas mal de Français étaient curieux de mieux connaître l’Afrique dont ils avaient parfois une image misérable.
En organisant des spectacles, des concerts, des défilés comme « Fashion for Peace », le défilé pour la paix et le climat, la Maison de l’Afrique a montré les côtés positifs du Continent et la richesse des 55 pays de l’Union africaine. Aidée par la ville de Montpellier, où je suis jeune élue et où j’ai intégré le Conseil des étrangers, cette « Maison de l’Afrique » a pour vocation de faire la promotion à la fois économique, numérique et culturelle du Continent.
Un prochain Sommet Afrique-France devrait d’ailleurs se dérouler à Montpellier en octobre 2025. C’est un scoop !
En savoir plus :
www.peulhfulani.com